« Sculpter l’identité » - Conférence au MAC VAL - Musée d'Art Contemporain du Val-de-Marne
En conversation avec Frank Lamy, responsable des expositions temporaires du musée
Avril 2023
Entretien sur Saison Video (mars 2024)
à propos de Là où naissent les ruines et le cycle Iterative Memories of Cantor Dust Man
par Mo Gourmelon
Mo Gourmelon : A l’occasion de l’élaboration de votre nouveau projet « Là ou naissent les ruines » (2023, ville de Toulouse, Cantor Dust Lab), vous m’avez déclaré souhaiter développer une série qui prolonge l’histoire et l’univers de « Cantor Dust Man » (2009 Le Fresnoy) et le suivant « Puzzle 3D » (2010 avec la Géode). Vous poursuiviez en disant que comme ces deux films vous aimeriez garder la forme expérimentale, hybride, la liberté que vous aviez pour ces projets guidés par des idées plastiques et conceptuelles.
Tout d’abord d’où vient ce nom Cantor Dust plutôt joli et poétique et que l’on sent « fabriqué ». Pouvez vous nous présenter cet ensemble que vous avez nommé « Iterative Memories of Cantor Dust Man » ? Comment « Là ou naissent les ruines » vient-il incarner une suite ?
Sébastien Loghman : Le titre de la série « Iterative Memories of Cantor Dust Man » vient de « Cantor dust » qui signifie, en anglais, « poussière de Cantor ». Cet ensemble mathématique a été « fabriqué », pour reprendre votre expression, par le scientifique du 19ème siècle, Georg Cantor. Il s’agit du premier exemple de fractale de l’histoire des mathématiques. Pour situer, les fractales étaient déjà dans la nature avant d’apparaître dans les maths. Par exemple, prenez le chou romanesco qui apparaît dans mon film Cantor Dust Man : si vous regardez un détail de ce légume, ce détail ressemble au chou dans sa globalité. Ainsi, on retrouve la même structure à différentes échelles. Et c’est vrai aussi pour les montagnes, les flocons de neige et les côtes de la Bretagne.
L’idée de « Cantor Dust Man » consistait à mettre en scène la pluralité d’un être. Le personnage Romanesco y raconte avoir vécu plusieurs vies, et chante qu’un souvenir contient un souvenir qui contient un souvenir, etc… Le film en relief Puzzle 3D en est une suite : le personnage Romanesco a vieilli et cherche dans un souvenir un objet qui manque à sa collection.
Le film « Là où naissent les ruines » traite de la mémoire qui forme l’identité et, comme dans les autres productions d’ « Iterative Memories of Cantor Dust Man », c’est un film très musical dont j’incarne le protagoniste.
On peut donc y voir un épisode alternatif de la série. Il s’agirait d’une vie de Romanesco, parallèle à la comédie musicale « Cantor Dust Man » et « Puzzle 3D ». Romanesco a de multiples lignes de vies et le temps n’est pas si linéaire.
MG : Toutefois, cette série ne comporte pas que des films : elle est née d’un dessin et elle en génère d’autres, ainsi que de la musique. Toutes ces itérations se font écho et se nourrissent conceptuellement.
SL : Tout à fait. Par exemple, j’ai réalisé l’installation de dessins « No Place Like Home » en écho au film « Là où naissent les ruines ».
Elle est composée de deux grands dessins au feutre et à la pierre noire, suspendus dos à dos. D’un côté le profil droit d’un visage, de l’autre, le gauche. Tel une cage, ce visage très géométrique est composé uniquement d’arrêtes aux couleurs de la peau et des cheveux. À l’intérieur de cette « tête cage » se trouve un prisonnier miniature. Pour dessiner ces profils de la « tête cage », j’ai d’abord scanné en trois dimensions ma tête, aplati ce volume en 2D pour le faire dessiner en grand, au crayon, par un ploter (une machine à dessiner de l’artiste Nicolas Guillemin) et j’ai finalement repassé cette esquisse aux feutres de couleurs. Enfin, j’y ai emprisonné le petit personnage, que j’ai dessiné à main levée à la pierre noire.
Cette liberté de passer d’un médium à l’autre est le fondement du cinéma et de la vidéo : une somme de médias qui ne font plus qu’un. Exactement comme de se dire, à l’inverse, qu’un artiste est une personne qui se multiplie. J’adore l’idée d’art total mais aussi le principe transmédia d’un univers étendu par-delà les supports.
MG : « Là où naissent les ruines » met en scène un condamné à mort à qui l’on accorde selon une ultime compassion en quelque sorte une dernière cigarette. D’où vient tout à coup la dimension tragique de ce nouveau projet ?
SL : Jusqu’ici, mon travail a toujours pris naissance dans la mélancolie et l’angoisse. Dans mes films, ce sont les conflits internes des personnages qui jaillissent à l’image.
Mon intérêt pour le sujet de la privation de liberté est né assez tôt. Mes origines iraniennes m’ont sensibilité particulièrement à ce propos. En Iran, mon grand père est mort en prison. Mon père et moi ne pouvons pas aller dans mon pays d’origine au risque d’y être enfermés pour “espionnage”; ou d’autres raisons arbitraires.
En 2013 était rendu public le témoignage de Monique Mabelly sur la dernière exécution en France, en 1977. Dans ce document, la magistrate décrit les ultimes minutes, la situation obscène de ce spectacle, avec une empathie irrésistible. Le condamné fume sa dernière cigarette et il sait qu’à la dernière bouffée, il sera précipité dans la cour des Beaumettes et, comme disait Badinter, il sera « coupé en deux ».
J’ai été bouleversé par ce texte et je m’étais juré de l’adapter. Mais je ne me sentais pas prêt.
Dix ans plus tard, j’expose au Castelet de Toulouse et le projet semble sur mesure car avant d’être un lieu d’exposition, le Castelet appartient au patrimoine, mais pas le plus heureux : c’est une ancienne prison. J’ai donc d’abord écrit quelques versions de scénarios adaptant les dernières minutes du dernier guillotiné de France, Hamida Djandoubi. Peu satisfait d’une adaptation littérale, j’ai passé un an à faire des recherches, me documenter sur la peine de mort et le quotidien des détenus en France, aux Etats-Unis, en Iran...
J’ai ainsi, dans la foulée, écrit le scénario d’un autre projet de film sur le sujet : « Des nuages dans un bocal ».
Contraint par le temps et l’argent, j’ai voulu formuler une expression simple et épurée, ce qui a donné le film Là où naissent les ruines.
J’ai cherché ce que j’avais en commun avec un prisonnier ; pour aller plus loin, ce que nous, les gens de l’extérieur, les « innocents », avons en commun avec un condamné à mort. Il y a d’abord l’intériorité qui s’oppose à l’extérieur, hors des murs, mais aussi qui s’oppose à la persona, notre surface.
Surtout, j’ai ressenti viscéralement le vertige face à la disparition. Nous nous divertissons pour ne pas y penser, mais évidemment elle est imminente, elle nous concerne tous et toutes. Je me suis alors projeté dans cette situation.
MG : Le tintement implacable de l’horloge, il est 4h, la consumation de la cigarette, scandent la durée du film, matérialisent le compte à rebours. Cette fois le corps est contraint après avoir été dans vos précédents films scindé, multiplié à l’infini « fractalisé », traversé. Puis le film bascule dans une autre dimension. On entend : « Qu’est ce que tu feras quand tu sortiras ? ». Noir. Gros plan du condamné. Blanc. Face à cette impossibilité, la liberté et la vie des pensées intérieures luttent-elles contre la mort imminente ? Comment avez vous conçu organisé ces scènes suivantes ?
SL : Le film est structuré en épanadiplose, c’est-à-dire qu’il se boucle sur lui-même, il finit sur le même plan vide de la chaise et l’horloge, comme une remise à zéro du compteur. À la fin du film, la place est libre pour le prochain.
Il commence par une entrée de champs, exactement comme au théâtre. Ceci fait référence aux dernières minutes des condamnés à mort aux Etats-Unis. Encore aujourd’hui, une séance américaine a lieu en journée pour permettre aux visiteurs d’y assister. Ainsi peuvent venir la famille du condamné et celle de la victime. En France, des années 1940 (fin des exécutions sur la place publique) à 1977, cela avait lieu face à une dizaine de professionnels du monde carcéral, de la justice, du personnel religieux… Bref, face à des spectateurs, mais avant le lever du soleil, comme une chose honteuse que l’on cachait dans les coulisses de la justice, entre gens du métier.
En France toujours, durant ses dernières minutes, le condamné avait les mains liées et on l’asseyait sur une chaise devant son public. Puis venait le rituel de la cigarette et, spécialité française, le verre de rhum.
Dans mon film, les mains des surveillants, qui semblent maintenir (ou soutenir) le condamné, évoquent une situation durant les exécutions américaines. Il arrive ainsi que des surveillants contiennent le condamné pendant que d’autres le sanglent sur son lit d’exécution.
En somme, mon film mixe les références françaises à celles des Etats-Unis pour toucher à une forme plus allégorique. Le mélange, l’hybridité, l’impureté font parti de mon travail. Les inspirations américaines viennent du fait qu’une partie de ma famille vit là bas, j’y ai étudié et je trouve la culture française encore fortement sous influence américaine.
Au bout du compte, nous ne savons pas à quelle époque le film se situe et nous ne connaissons pas l’objet de la condamnation. Ce qui demeure, c’est l’humain.
À partir du moment où il fume, le condamné part dans ses pensées. La réminiscence d’une voix féminine (« Qu’est-ce que tu feras quand tu sortiras ? »), enclenche le flot. Ses pensées représentent-elles une réponse littérale, que ferait-il s’il pouvait sortir ? Sont-elles des souvenirs ? Peu importe. Tout imaginaire n’est qu’une adaptation mémorielle, projection vers devant en prenant appui sur avant.
Mais surtout, ce qui est extérieur à la prison est devenu pour lui une virtualité : avant, pendant et après.
MG : Justement j’aimerais vous lire sur l’adéquation des pensées intérieures avec les images virtuelles. Comment ont-elles été façonnées. Cette impression que l’on a de flotter entre souvenirs ou rêves. Vous pourriez aussi aborder la relation avec la musique, que l’on n’a pas encore évoquée.
SL : Pour les images mentales du film, j’ai voulu des lieux et personnes évoquant des aspects importants d’une vie qui pourraient manquer au détenu. Être en extérieur, dans la nature ou en ville ; l’amour, les amis, la famille…
Pour cela, j’ai capturé des scans 3D. J’ai choisi un rendu 3D en « fils de fer », ce qui peut évoquer une cage bien sûr, mais aussi une toile tissée par la mémoire.
Je tenais aussi à ce que les couleurs demeurent sur ces arrêtes, pour qu’on ressente toujours une immersion dans un espace qui a existé.
J’ai gardé les imperfections de ces captations 3D. Mon but est de jouer sur l’ambiguïté de ces espaces virtuels. Dans leur fabrication, ils sont des empreintes inachevées de la réalité. Pourtant, dans le contexte du film, ils sont aussi des ruines. Par exemple, il y a un espace intérieur où l’on peut entendre du vent qui s’engouffre par les « trous » dans les murs. Ces trous sont des artefacts du scan 3D. Des arbres en extérieur, il ne reste souvent que des troncs. La chambre finit par disparaitre, se désintègre et s’éloigne de nous dans le néant.
Concernant la musique de mes films, ce sont les émotions qui guident ma composition. La mélodie prime, le rythme suit. Elle a une part importante dans la série « Iterative Memories of Cantor Dust Man ». C’est flagrant dans la « comédie musicale » pour soliste, Cantor Dust Man.
J’ai l’impression que notre rapport à la mélodie est d’abord culturel. Pour ma part, j’ai été formé au classique, puis j’ai joué de la batterie dans des groupes de rock, chanté dans d’autres et finalement j’ai mené mon projet musical solo. Depuis mon film « Puzzle », je produis mes musiques de film en improvisant sur un instrument (piano, guitare…) face à l’image. Ensuite je fixe l’improvisation en la rejouant, parfois à l’identique. Enfin, j’arrange si j’en ressens le besoin, j’ajoute d’autres instruments… Je suis donc d’abord spectateur de mon montage et j’exprime cet état par la musique.
En général, la musique m’aide à traduire les sensations du personnage. Souvent il est d’ailleurs personnifié par un instrument. Dans Cantor Dust Man, c’est le piano et sa richesse chromatique qui fait écho aux multiples visages (c’est un instrument orchestre en soit, ce n’est pas pour rien qu’il est la base de beaucoup de compositeurs).
Dans Là où naissent les ruines, la guitare est l’instrument que je trouvais à l’échelle du prisonnier. Ici, globalement la musique flotte, elle est en suspension, comme la vie du condamné durant cet instant. Dans un principe d’épure, j’ai préféré qu’elle soit éthérée, pleine de réverbération. Une note fait écho à l’autre, à l’octave par exemple, créant une sensation d’équilibre… Cela produit un paradoxe. Nous savons être face à un drame. Pourtant, beaucoup de condamnés à mort se sont préparés à la mort et partent sereins.
Et malgré cela, des arpèges obsessionnels tournent sur eux même comme une vis qui approfondit là où peut-être, on préférerait rester en surface.
Une ritournelle qui rappelle à la réalité.
Article dans la revue ‘Parcours des arts Sud et Espagne' nº 76
à propos de l'exposition personnelle au Castelet de Toulouse
Texte de Yann Le Chevalier (2023)
VERTIGE DE LA MORT
EN PARALLÈLE À L'EXPOSITION DOCUMENTAIRE 'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT' (la dernière exécution en France date de 1977)
Sébastien Loghman aborde des questions qui ne lui sont pas familières. Étonnamment, il trouve des similitudes entre l'artiste et le prisonnier : « L'artiste est souvent isolé et inversement certains prisonniers deviennent artistes. En fait, tous deux sont voués à l'introspection pour mieux comprendre qui ils sont. » Dans son film La Dernière Cigarette, Loghman met en scène les pensées d'un condamné.
Les images de la réalité deviennent des dessins « faits machine » avec des maillages simulant les reliefs de scènes dont l'atmosphère oscille entre inachevé et ruine, mémoire et oubli. Des images de vie quotidienne et de rêve Le dessin à double face qui accueille le visiteur montre un homme dessiné à main levée intégré dans un visage issu d'un scan en 3D : ici, le vivant s'oppose à la contrainte, la réalité fait face au virtuel.
Catalogue ‘Histoires vraies’
MAC VAL - musée d'Art contemporain du Val-de-Marne
Texte de Sarah Ihler-Meyer (2022)
Il y a des fictions vitales, dont celles qui donnent une unité à une multiplicité d’éléments autrement épars. C’est notamment le cas de la notion du « moi », entendu comme « sujet » identique à lui-même, stable, permanent et non contradictoire. L’on sait, depuis l’avènement de la psychanalyse, que celui-ci est en réalité divisé entre conscient et inconscient, mû par des pulsions contradictoires et des affects ambivalents. Précisément, cette notion est au centre du travail de Sebastien Loghman, à la fois musicien, plasticien et cinéaste.
Ainsi de son cycle intitulé Iterative Memories of Cantor Dust Man depuis 2003. Celui-ci a commencé par la réalisation d’un autoportrait dessiné en 2003 (Envisager), représentant le visage de l’artiste constellé d’une myriade de petits visages schématiques. Il préfigure le personnage de Romanesco, double fictionnel de Sebastien Loghman empruntant son nom au chou romanesco, un légume dont la structure fractale – aux motifs similaires à toutes les échelles – rejoint l’idée d’une multiplicité formant une unité. Joué par l’artiste, Romanesco apparaît dans deux courts métrages musicaux. Le premier, réalisé en 2009 (Cantor Dust Man), le montre dans un appartement tiré au cordeau, tel un décor de théâtre aux couleurs vives et chaudes, en train de déguster une soupe de chou romanesco : à peine introduite dans sa bouche, celle-ci lui rappelle son enfance. Accompagné d’une musique qu’il a lui-même composée, il chante alors le sentiment d’étrangeté qui le saisit, ne se reconnaissant plus dans cette période, tandis que son visage se subdivise en une foule de visages eux-mêmes subdivisés en d’autres visages, toujours à son image.
À cette mélopée lancinante répond un second court métrage, Puzzle 3D, tourné en 2010. On retrouve ici Romanesco vieilli, devant une boîte à souvenirs dont l’un des objets a disparu. Tandis qu’il s’immerge dans un bain, un souvenir de sa jeunesse remonte à la surface : un pique-nique au bord d’une rivière, dans les années 1960, au cours duquel l’une des deux femmes qui l’accompagnent lui offre un coquillage fossilisé. Ce dernier apparaît alors entre ses mains vieillies et trouve sa place, dans son petit compartiment en bois. Si, dans le premier film, les processus de la mémoire démultiplient Romanesco en une kyrielle de facettes, dans le second, au contraire, ces processus réunifient des fragments de vie disjoints. Soit deux opérations a priori opposées mais qui dévoilent, l’une comme l’autre, la nature fictionnelle du « moi », ou plutôt le « moi » comme « fixion ». Contraction des mots « fiction » et « fixation », le terme « fixion » a été inventé par Jacques Lacan pour désigner les fictions que l’on a-colle au réel lorsque celui-ci échappe. Une fixation néanmoins plastique, sujette à transfigurations.
Portrait dans le Quotidien de l'Art
‘Sebastien Loghman-Adham, homme orchestre’ de Juliette Soulez (2022)
Extraits :
"Les nouvelles technologies sont des opportunités de créer un monde d’images rémanentes immergeant le spectateur dans les univers parallèles de la mémoire intime ou personnelle et d’imaginaires colorés mais inquiétants au sens freudien. Les cycles, selon ses mots, de son travail sont à la fois une manière de classer ses œuvres et d’ajouter chaque fois une fenêtre nouvelle à des thèmes qu’il ne cesse d’explorer.
Comme avec un kaléidoscope, il construit une œuvre multi-canal, labyrinthique et polymorphe qui a déjà été de multiple fois primée, exposée ou diffusée dans le monde et où il se met en scène et s’expose, ou compose des rôles pour des acteurs dans des fictions cinématographiques.
[...] L’insistance et la répétition des motifs de l’inquiétante étrangeté et la dérision, puisent dans des mondes invisibles comme la mémoire ou le fantastique (qu’il connaît bien pour avoir notamment longtemps travaillé autour de Lovecraft et la réalité virtuelle). Et comme les Portraits 2020 de travailleurs de la culture qu’il a réalisés au crayon pendant le confinement jouant sur le masque et l'invisibilité du visage, le dessin a une place souvent initiale dans son travail.
Conférence au SILENCIO, Paris
En conversation avec Violaine Boutet de Monvel, critique d’art (2019)
Conférence à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris
conversation avec Isabelle Danel, critique de cinéma (2010)
Extrait vidéo à propos de Puzzle 3D
Extrait vidéo à propos de Je ne connais pas d’Alice
Article dans la revue Archée (CANADA)
Bertrand Gervais

On comprend que la force de l’œuvre hypermédiatique de Sébastien Loghman, Adam’s Cam, repose sur les effets d’interactivité qu’elle suscite.
Le dispositif est d’une grande simplicité, du moins en apparence. La fenêtre du fureteur est entièrement noire, sauf pour un rectangle en son centre, une fenêtre enchâssée de teinte sépia, où l’on voit d’emblée une femme nue étendue sur un drap. Elle est photographiée en plan américain, l’on ne voit que le haut de son corps, son tronc, sa tête et ses bras. Elle dort sur le ventre et son visage nous est caché. L’image, elle aussi, est d’un grand dénuement. Le mur du fond est anonyme, sans aspérité, et aucun accessoire n’est présent qui pourrait permettre de dater la scène. Nous sommes face à une représentation minimale : une femme nue couchée et endormie. Nous n’en saurons pas plus. Les seules informations disponibles sont révélées par une ligne de texte sous la fenêtre de l’image. Or, ce sont nos propres déterminations spatio-temporelles qui sont affichées. Nous voyons en effet écrit en rouge sur fond noir l’heure exacte de notre visite sur le site ainsi que le jour, la date et l’année.
Article dans VICE – the Creators Project
Pierre Berthelot Kleck
En mélangeant stop motion, film classique et costumes et univers détonants, [IchRU] captive et nous pousse à la réflexion sur les dérives de la consommation à l’ère informatique.
Article dans la revue Protée (CANADA)
Bertrand Gervais et Mariève Desjardin
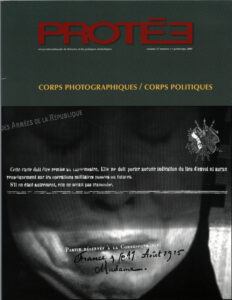
LE REGARD D'ADAM ET LA MAIN DE L'INTERNAUTE
Adam's Cam, l'œuvre de Sébastien Loghman de 2005, met en scène une dormeuse, une femme qui nous échappe malgré sa très grande vulnérabilité. La fenêtre de l'ordinateur qui s'ouvre sur sa couche apparaît comme un parfait équilibre entre présence et absence, entre ce qui est offert et ce qui est refusé.
Et c'est sur cette tension que sa nudité devient une expérience esthétique. Mais nous pouvons, à l'aide d'un curseur, la faire réagir. Elle ne se réveille jamais, son sommeil est simplement perturbé par nos manipulations, et. elle n'offre à notre regard que sa figure endormie en partie dissimulée par un drap ainsi que l'angle de la caméra. r interactivité nous permet de manipuler l'image, de faire réagir le corps qui y est reproduit. Comme le suggérait Tisseron, l'image est une surface que l'on peut transformer avec ses mains.
L'oeuvre de Loghman est d'une grande simplicité, du moins en apparence. La fenêtre du fureteur est entièrement noire, sauf pour un rectangle en son centre, une fenêtre enchâssée de teinte sépia, où l'on voit une femme nue étendue sur un drap. Elle est photographiée en plan américain, l'on ne voit que le haut de son corps, son tronc, sa tête et ses bras.
Elle dort sur le ventre et son visage nous est caché.
Livre Abécédaire du Web
Joanne Lalonde, éd. PUQ Numérique (CANADA)

Adam’s CAM de Sebastien Loghman est une œuvre qui fait comprendre cette portée du « hors-temps » ou « des temps de présents probables » qui ne demandent qu’à s’actualiser dans l’expérience de l’œuvre. Encore ici, l’évocation du filmique et du vidéographique est importante. À la source de cette œuvre se trouve le point de vue, un concept fondamental pour penser toutes pratiques artistiques. Ce point de vue se trouve incarné par la caméra, laquelle est nommée dans le titre mais invisible comme dispositif, cachée mais pourtant centrale.
C’est pourtant par elle que nous pouvons voir la séquence unique de l’œuvre, celle d’une femme allongée que l’on regarde dormir. Plus que jamais ici, ce point de vue s’incarne par le regard que porte le spectateur sur la scène jouée et rejouée en boucle, dans un présent éternel et inépuisable.
Métaphore originelle ou scène primitive, la naissance de l’homme dans la culture biblique, ce regard d’Adam porté par la caméra numérique devient une renaissance de l’image pensée dans un hors temps. Dans cette absence de repères temporels, il n’y a pas plus de passé que de futur, mais un continu infini, insistant sur le présent affectif du spectateur et sur son temps de réception qui devient alors le temps principal de l’œuvre.
Toute l’expérience esthétique se recentre donc sur celui-ci, sur son regard qui se substitue à celui d’Adam alors qu’il explore l’œuvre à travers une interface simple qui lui permet de faire bouger légèrement le personnage, lequel lui échappe en partie, car il ne se tournera jamais de son côté. Qu’il soit témoin ou espion (les deux modes de navigation proposés pour l’accès au site), l’internaute se trouvera face à son propre regard, dans lequel s’affiche en caractères rouges le temps présent de sa réception (Tuesday, 24 may, 2011, 11:51:06, 11:51:07, 11:51:08) égrenant une par une les secondes d’une éternité infinie quoique rendue abstraite par la frontalité du spectacle. Comme une insistance sur le moment présent dans une urgence de voir et dans une violence relative où on ne peut plus raconter de la même manière, le spectateur se trouve alors, rappelle Couchot, « entre deux temporalités antagoniques », oscillant et déchiré « entre le temps uchronique et le temps de l’Histoire » (2007, p. 279).
Livre Pratiques performatives, Body Remix
dir. Josette Féral - éd. Les Presses de l’Université du Québec (CANADA)
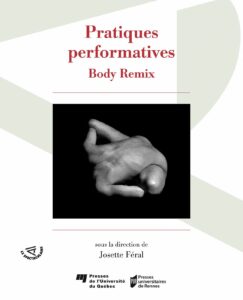
Extrait :
L’Eve virtuelle d’Adam’s CAM est une figure qu’on voudrait manipuler à notre guise. Et l’interactivité de l’œuvre nous incite à croire la chose possible. Nous pouvons bel et bien, d’un simple geste, animer ce corps, le forcer à se soulever de sa couche et le faire répondre à nos ordres. Comme toute figure, cette Eve apparaît comme un corps transparent. Un corps lisse, qui peut répondre à nos fantasmes de démiurge. Bien vite, cependant, la figure se met à résister. Comme un corps réel, elle reste opaque et refuse de se plier à tous nos ordres. Elle ne se retourne pas, malgré nos demandes pressantes. Elle reste endormie, nonobstant toutes les mauvaises pensées que nous pouvons lui avoir envoyées. L'illusion de présences s’estompe et l'on devine finalement que cette webcam (Adam’s Cam) n'est rien d'autre qu'une supercherie (Adam's SCAM).
L’interactivité provoque des effets de présence qui dotent les corps virtuels d'une très grande désirabilité, de celle capable de faire fondre les strates de médiation pour laisser l'illusion à l'internaute qu'il est en présence d'un corps animé, d'un corps non seulement désirable, mais capable de répondre à ce désir.
Cette interactivité est au cœur d'un des mythes les plus important du cyberspace.
Car, grâce à ses dispositifs, on croit pouvoir procéder à des représentations d'une efficacité absolue et mettre en scène des corps virtuels, qui passeront pour des corps réels et feront oublier les strates de médiation nécessaires pour les animer.
L’interactivité est l'un des facteurs, avec l'immédiateté et la singularité, permettant de susciter des effets de présence d'une indéniable portée. Si les avatars et autres images 3D offrent des squelettes virtuels habillés de peau et de textures qui laissent croire à la présence d'une figure humaine, Celle présence ne s'impose véritablement qu'à partir du moment où une interactivité intervient. Elle est une illusion qui accentue les effets de projection et d'identification des internautes.
Articledans Le Journal des Arts
Exposition Jean Bonna, la fabrique du dessin - Guillaume Morel

Extrait :
Parmi les jeunes artistes qui exposent dans la salle Melpomène, une mention spéciale peut être attribuée aux dessins monumentaux d'Antoine Desailly et à la vidéo interactive de Sébastien Loghman, Le Sommeil (prière de ne pas toucher), où le visiteur peut, en touchant l'écran, jouer avec une jeune femme endormie.
Article dans Lunettes Rouge - Le Monde
Marc Lenot
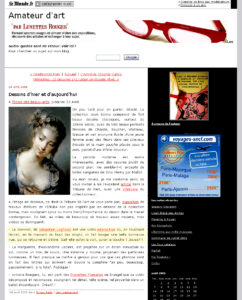
Extrait :
... trois vidéos se distinguent :
Le Sommeil, de Sébastien Loghman est une vidéo interactive où, en touchant l'écran, en le massant du bout des doigts, on fait bouger une belle dormeuse nue, qui se retourne et s'étire. Sait-elle qu'on la voit, qu'on la touche ? Jouissif !
Article dans L'Orient Le Jour (LIBAN)
Exposition Beyrouth Utopie

Extrait :
Onze regards artistiques qui n'ont rien de convenu, dont on retient surtout celui de Sébastien Loghman, qui cherche à travers une série de photos numériques de différents halls d' immeubles à exprimer la diversité de la société libanaise. Tandis que dans un autre registre, celui de la mémoire, du temps et de ses fluctuations, il présente Un endroit où se cacher, un travail qui s'approprie un vieux baril rouillé, symbole de la guerre, pour en faire le thème d'une «sculpture-vidéo ».
En se penchant pour regarder dans le trou du tonneau, le spectateur voit d' abord l'image d'un garçon qui s'engloutit dans l'eau pour réfléchir, ensuite celle d'un jeune adulte. Évocation d'un mythe, celui du reflet de l'avenir dans l'eau du puits, cette oeuvre monlre le nouveau visage - plus mature ? - d'une ville, ou peut-être de ses citoyens, qui ont grandi à l'ombre de la guerre.









